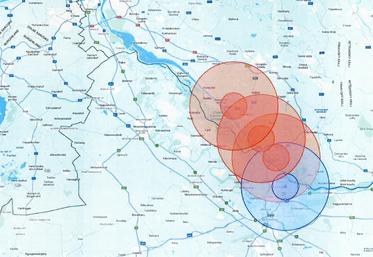Le sursemis permet de conserver l’équilibre et la portance du sol
Quelle que soit la méthode de rénovation retenue pour une prairie, elle doit toujours être réfléchie à l’issue d’un diagnostic complet (flore, environnement, pratiques et objectifs de l’éleveur) qui permettra d’identifier les causes de dégradation et de conseiller les espèces et variétés adaptées à la situation.
Quelle que soit la méthode de rénovation retenue pour une prairie, elle doit toujours être réfléchie à l’issue d’un diagnostic complet (flore, environnement, pratiques et objectifs de l’éleveur) qui permettra d’identifier les causes de dégradation et de conseiller les espèces et variétés adaptées à la situation.

Choisi souvent car moins risqué pour le bilan fourrager, le sursemis reste une solution qui réclame de la technicité. Cela consiste à implanter des semences sans détruire le couvert en place ou en éliminant juste des plantes indésirables par un désherbage sélectif.
À quelle période faut-il sursemer ?
Deux choix sont possibles avec une préférence pour le sursemis de fin d’été pour éviter la concurrence du couvert existant.
Le sursemis au printemps est idéal pour de l’entretien de flore (dose de semis < 10 kg/ha). Il est intéressant pour regarnir les trous de taupinières ou autres avant la mise à l’herbe. Il garde l’humidité généralement présente pour la germination. En revanche deux points de vigilance sont à prendre en compte. Il faut veiller à faucher précocement pour apporter rapidement de la lumière au jeune semis, et faire attention à la sécheresse printanière puis estivale si le semis intervient après la première fauche.
Le sursemis de fin d’été permet un éventuel désherbage sélectif de printemps sans risque de rémanence. Il ressort une moindre concurrence du couvert existant (croissance ralentie) et des conditions sèches pour éliminer les adventices (hersage agressif préalable). Dans ce cas aussi, deux points de vigilance sont à retenir : le risque d’une humidité limitante pour une levée homogène et ne pas intervenir après le 30 septembre.
Quelles sont les règles élémentaires ?
Plusieurs règles élémentaires sont à suivre :
- intervenir sur une végétation rase (< 5 cm) ;
- choisir des espèces agressives et à installation rapide (RGA, RGH et bromes pour les graminées et trèfles blanc et violet en légumineuses). Il faut éviter les fétuques, le dactyle et la fléole dont l’installation est lente à très lente ;
- semer dans de bonnes conditions agronomiques : sol affiné, réchauffé, avec une humidité résiduelle :
- dose de semis d’environ 15-20 kg/ha. On peut descendre à moins de 5 kg pour sursemer du trèfle en regarnissant un couvert de graminées satisfaisant ;
- positionner les semences dans le premier cm surtout en semis à la volée.
Ensuite, c’est le matériel utilisé qui imposera des étapes particulières.
Avec quel matériel ?
Le matériel spécialisé pour le semis direct à disques ou sabots, souvent coûteux, sème en ligne. Les résultats sont généralement très bons car le contact terre-graine est bien assuré. Toutefois, en cas d’humidité trop importante, le risque est de parfois lisser le sillon compliquant l’enracinement des plantules. Par ailleurs dans les zones très dégarnies, les interlignes sont vite colonisées par des adventices.
La herse à prairie équipée d’un semoir centrifuge offre un semis à la volée avec un recouvrement de la graine parfois superficiel. Cette solution plus économique nécessite un passage préalable car il faut intervenir sur un sol ouvert (espaces libres et finement terreux). L’hersage agressif et/ou désherbage est sélectif. L’hersage permet d’éliminer la végétation morte et de faire apparaître de la terre fine en surface.
À l’issue du semis, il faudra impérativement rappuyer le sol avec un rouleau non lisse.
Astuces et recommandations
- Traiter au glyphosate à très faible dose (1 l/ha) pour freiner le couvert et non le détruire.
- Faire pâturer les animaux juste après le sursemis pour consommer la végétation existante et rappuyer les semences en cas de semis à la volée.
- Éventuellement refaire pâturer un mois après le sursemis pour maîtriser le couvert existant.
- Ne surtout pas apporter d’azote au risque de favoriser la flore présente.
- Surdoser de 10 % la quantité à semer pour limiter l’impact de la microfaune (taupins…).
- En cas de présence d’agrostis stolonifère, les substances anti-germinatives secrétées par les stolons imposent une destruction totale de la flore avant l’hiver pour effectuer un resemis au printemps.
En résumé le sursemis évite une interruption de la production de la prairie et limite légèrement le coût de rénovation d’une prairie. Il conserve l’équilibre et la portance du sol au contraire d’un resemis avec travail du sol et limite le risque d’érosion. Il reste la seule possibilité si des contraintes environnementales, règlementaires ou climatiques empêchent le resemis. •